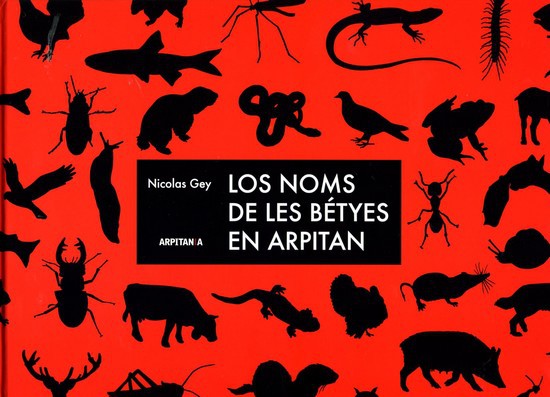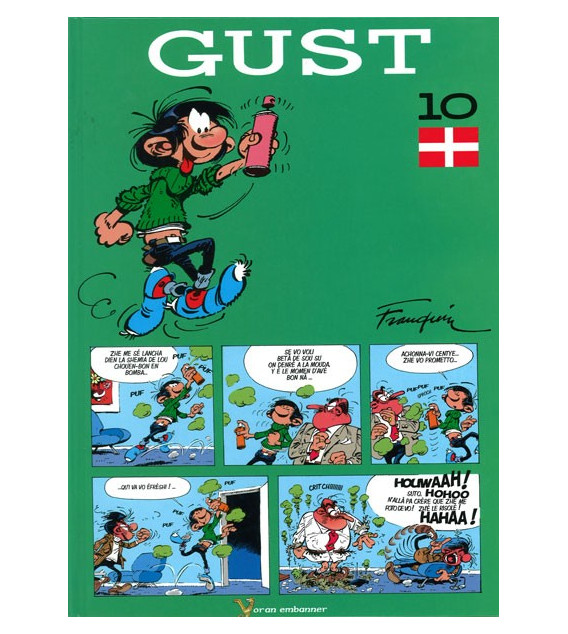« Mademoiselle », comme on appelle Amélie GEX à la Chapelle Blanche, a le visage fermé. Ses beaux yeux si doux semblent éteints, ses traits habituellement empreints de bonté sont tirés et durs. Aujourd’hui, en ce printemps 1875, « Mademoiselle » quitte sa propriété de Villard-Martin, en grande partie vendue pour une bouchée de pain. Celle de Villard-Léger a été vendue le mois dernier sans parvenir à combler toutes les dettes du docteur Gex et, sans fortune, presque sans le sou, « Mademoiselle », part définitivement avec son amie Annette, pour Chambéry, rue de la Trésorerie.
Elle a tort de s’attrister, car à Chambéry elle va découvrir une autre vie et révéler aux yeux de tous, ses grands talents d’écrivain. Mais elle ne le sait pas encore.
Rue de la Trésorerie, la maison est triste, insalubre, trop chère. Un déménagement pour un appartement rue de la gare s’impose. Mais sans argent, c’est toujours le trou noir, jusqu’au jour où son cousin Charles Burdin, ami de l’imprimeur Ménard, lui propose d’écrire dans le journal du Père André.
Pour Amélie, c‘est enfin la possibilité de gagner sa vie et puis, le Père André, journal républicain, lui convient parfaitement, car elle aurait gardé sa foi en Dieu, mais a depuis longtemps envoyé par dessus l’épaule la foi en l’Eglise. Outrée par le comportement scandaleux du curé de la Chapelle Blanche, outrée par les abus du clergé toujours acoquiné avec le pouvoir qu’elle dénonce, elle ne pratique plus sa religion, défend le petit peuple, veut instruire les paysans, soutenir la vie des femmes et le journal lui offre une tribune exceptionnelle.
Mais, comment écrire ? Les encouragements de Mme Marcillac la stimulent, mais ne suffisent pas. Elle souffre le diable ! Ses rhumatismes la torturent. Tenir sa plume est un supplice. Jamais elle ne pourra réussir. Pourtant, il faut vivre et elle a grande envie de vivre ! A la Chapelle Blanche elle avait écrit quelques poèmes, « avec (son) coeur et un peu de lecture », mais aujourd’hui, il faut écrire pour le journal et en français, puisqu’ « on est français jusqu’au cou !». Elle va faire ce qu’elle sait faire : des poèmes. Ils feront chanter le Père André et, espère-t-elle, chanter l’« émo » des Savoyards.
Comme les temps sont à la politique, son premier poème est : L’opinion de Jean sur les élections, pour dire leur fait aux hommes politiques truqueurs, menteurs qui profitent des petits et des humbles. En voici quelques extraits :
Le pêinsé de Dian chu le-s-élechon
Air : Allobroge vaillant
Dêpoué voui zord d'ai rechu pe la pôsta
D' què fâr'on moué de lettre et de zornaux.
D'êin ai rechu mé que Monchu de Costa
Mê que le pape et tô so cardinaux.
U-s-abit blanc, u portu de blouse
Tô çlo papié font tant de compliméint,
Tant de-s-histuére et diont si belle chouse
Que plus de ion (bis) le comprêind pas lamint.
Refrain
Mâgré voutro discor et mâgré voutro prôno,
Incroâ de Savoué,
Et vo, nôble-s-avoué,
Le râi n'ira p'onco s'achètâ su son trôno
Si lu faut ma voué, rien que ma voué !
Noutra Sasson n'âme pas le-s-affiche
De lo marquis que m'appélont : « Monchu ».
- De çlo deniâ, quoui payera le miche ?
Dian, sara tê ; te pou comptâ dechu.
Y a bin longtêimps qu'i ramelon sêin cessa
Qu'i no baront plu d'bouro que de pan ;
Mais, va tié leû, comptêint chu leu promessa,
Avant d'êintrâ (bis) t'faré sovêint : pan ! Pan !…
Refrain
Mâgré voutro discor…
-Vouâ, t'â râison, Sasson, la Républica
N'a pas besuin, com' on râi, de valet,
Et chur, tié li, pe porta 'na supplica,
Lo païsan êintreront preu solet.
Léchon lo grou fâre leu reverance
Pe quinze jor, i no font bon séinblant,
I l'ont tot l'an pe se conflâ la panse.
Faut trop de brin (bis) p'ingréché lo bou blanc !
Depuis huit jours j'ai reçu par la poste
De quoi faire un tas de lettres et de jounaux.
J'en ai reçu plus que Monsieur de Costa,
Plus que le pape et tous ses cardinaux.
Aux habits blancs, aux porteurs de blouses
Tous ces papiers font tant de compliments,
Tant d'histoires, disent tant de belles choses
Que plus d'un (bis) ne les comprend pas seulement.
Refrain
Malgré vos discours et malgré vos prônes,
Curés de Savoie,
Et vous, nobles aussi,
Le roi n'ira pas encore s'asseoir sur son trône
S'il ne lui faut que ma voix, rien que ma voix.
Notre Françoise n'aime pas les affiches
De ces marquis qui m'appellent : « Monsieur ».
- De ces dîners, qui payera les miches ?
Jean, ce sera toi, tu peux compter dessus.
Il y a bien longtemps qu'ils rabâchent sans cesse
Qu'ils nous donneront plus de beurre que de pain ;
Mais, va chez eux, comptant sur leur promesse,
Avant d'entrer (bis) tu feras souvent : pan ! Pan !...
Refrain
Malgré vos discours...
- Oui, tu as raison, Françoise, la République
N'a pas besoin, comme un roi, de valets,
Et sûr ; chez elle, pour porter une supplique,
Les paysans entreront assez seuls.
Laissons les puissants faire révérence
Pour quinze jours, ils nous font bons semblants,
Ils ont toute l'année pour se gonfler le ventre.
Il faut trop de son (bis) pour engraisser les bœufs blancs !
D’autres poèmes agrémenteront les pages du Père André : La chanson des deux poulets célèbre le triomphe de la République, La complainte du conscrit, pleure avec le soldat qui prend « pour cinq ans de gamelle » et attend impatiemment la paix. Tous deux, ainsi que les suivants,
sont signés par Dian de la Jeânne, car la signature d’une femme ne ferait pas sérieux.
Tous les poèmes ont un grand succès. Amélie est heureuse. Elle chante et maintenant que la réussite se confirme, elle prévoit pour l’année 1878, une série de poèmes tout Au long de l’an. Ses douleurs sont toujours présentes, mais presque dominées par l’ardeur de la création littéraire et lorsque qu’en 1879, l’imprimeur Ménard lui propose la direction du journal le Père André, elle l’accepte avec grand plaisir.
Elle a la responsabilité de la direction et de la rédaction entière du journal. Amélie est aux anges. La charge de travail la distrait de ses douleurs. Elle va pouvoir s’adresser comme elle le souhaite à « ses paysans », les soutenir et surtout les instruire. Elle veut enseigner des méthodes de culture, promouvoir des rapports directs entre producteurs et consommateurs, dénoncer l’exploitation des paysans par des marchands sans scrupule, instruire les femmes de leurs droits, leur enseigner des règles d’hygiène, d’économie domestique de tenue de maison. Il y a tant à faire et à dire !…
Le journal est rénové, publié dans un format différent, plus grand. Chaque numéro comporte : Un bulletin politique, un article d’enseignement sur l’agriculture, des « conseils à la fermière », un « petit code législatif du paysan », des offres de demandes agricoles, une chanson ou une fable en patois inédite de Dian de la Jeânne.
Durant toute l’année 1879 le Père André s’adresse ainsi au monde paysan pour le plus grand plaisir de sa directrice. Mais un soir de février 1880, Amélie reçoit la visite de son cousin Charles Burdin, flanqué de l’imprimeur Ménard. Ils se sont réparti les rôles. L’air grave et avec hésitations, Charles s’adresse à elle :
– Tu sais Amélie, les temps ont changé, les élections approchent, il nous faut un vrai politique à la tête du journal…
Amélie a compris. Elle sait que son rôle à la tête du journal est terminé. Brusquement, un grand vide s’ouvre devant elle comme un précipice.
Ménard prend à son tour la parole.
– Nous aurons toujours besoin de toi, ma chère Amélie. Je vais créer un Almanach du Père André. Ce sera une petite brochure, pas chère, qui donnera « des renseignements utiles aux paysans et aux ouvriers » et dans laquelle Dian de la Jeânne pourra publier ses chansons. Et puis, dans l’Indicateur savoisien, pourront prendre place les contes que tu as écrits : les Récits de ma rue et de mon village et bien d’autres...
Amélie est émue. Tant de sollicitude la console de son échec avec le Père André. Aussitôt elle s’enflamme. Elle a tant à raconter. Si ses doigts qui la torturent le lui permettent, elle sait déjà ce qu’elle publiera dans l’Indicateur : des Récits étranges. Des vies antérieures ou récits spirites. Elle créera une nouvelle série : Histoire de ma rue et de mon village, avec des contes nouveaux : Jean de la Noce, Histoire de Roupioupiou la Sardagne, Histoire d’un tambour et d’un cheval de bois...
Mais ces contes ne paraîtront jamais. Un pèlerinage à Myans, change son programme. Révoltée par le spectacle qui est offert aux pèlerins, il faut qu’elle crie son indignation contre l’Église, hiérarchisée, insensible dans sa puissance, éloignée des préoccupations des pauvres. Elle écrit une élégie en prose : Notre-Dame de Septembre à Myans : « Ah ! s‘écrie-t-elle, à Myans l’antique sanctuaire savoisien… Tout était fait pour étonner et frapper l’esprit de ces paysans … Partout de l’encens, des lumières, de la musique, mais rien qui fut vrai, humain, évangélique… Eh ! Quoi prêtres, est-ce là ce que nous vous demandons ? Est-ce là ce qu’il faut à ces cœurs avides d’amour, à ces esprits confiants… ? »
Mais si elle réprouve les pratiques ecclésiastiques, elle croit en l’Evangile, aux paroles de charité et le Credo de Dian de la Jeânne affirme cet amour indéfectible pour les pauvres, sa confiance en un Dieu de miséricorde, tout en condamnant les « amateurs d’eleison » et les « croque-Jésus gloutons ». Aussi fait-elle paraître un long poème intitulé : A une âme sincère, qui affirme avec force et sensibilité sa confiance en Dieu et en la vie éternelle.
Son poème n’émeut guère ses proches plus éloignés qu’elle de la religion, mais touche si profondément la population des croyants, qu’Amélie Gex reçoit comme un paradoxe, une lettre enthousiaste de l’archevêque de Chambéry. A une âme sincère, est couronné par l’Académie de Savoie et un premier prix de 400 francs est attribué à son auteur.
Auparavant et non sans humour, Amélie Gex avait adressé au docteur Guilland, « ancien président de l’Académie de Savoie » et nommé bibliothécaire de cette Académie, un poème intitulé : Les Autrefois, dont voici quelques extraits :
A MONCHU LE DOCTEUR GUILLAND
anchin président de l’Académie de Savoé.
Le-s-aûtrefâis, conte ma mâre,
Quand elle a bio de vin borrû,
N'y avâit pas tant de savâi fâre !
Lo garçons n'étont pas si drus…
L'feille savont pas tant d'affâre…
On viviève à la bonne fâi,
Le-s-aûtrefâis !
Le-s-aûtrefâis, tié noutro maîtres,
Quand y étâit 'na bona saison,
Portu d'habits, portu de guétres,
Tô danchévont pe trolliéson :
Séin jalosie de chô bien-étre,
Çacon partadiève so drâits
Le-s-aûtrefâis !
……………………………………
Le-s-aûtrefâis, le zuéne feille
Portâvon beguenn'élardia,
Çeaûsse bien treya chu le greille,
Motiu de lânna tot frandia.
L'aront pas voliu rle manteille
Que vo-s-étes fières d'avai,
Le-s-aûtrefâis !…
Le-s-aûtrefâis, quand on blondâve,
On ne se catiève de nion :
Feille et garçons, tot cé modâve
Colli d'âlogne ou de guéfions ;
A l'éimbrouni quand on tornâve,
Çacon s'éinfelâve tié sâi,
Le-s-aûtrefâis !…
Le-s-aûtrefâis !...quâi set d'y dire !
On le fara pâs reveni !...
A MONSIEUR LE DOCTEUR GUILLAND,
ancien président de l’Académie de Savoie.
Les autrefois, raconte ma mère
Quand elle a bu du vin bourru,
Il n'y avait pas tant de savoir-faire,
Les garçons n'étaient pas si drus…
Les filles ne savaient pas tant de choses...
On vivait à la bonne foi,
Les autrefois !
Les autrefois, chez nos maîtres,
Quand c'était une bonne saison,
Porteurs d'habits, porteurs de guêtres,
Dansaient pour les pressailles ;
Sans jalousie de ce bien-être,
Chacun partageait ses droits,
Les autrefois !…
……………………………………
Les autrefois, les jeunes filles
Portaient coiffe élargie,
Bas bien tirés sur les chevilles,
Mouchoir de laine tout frangés.
Elles n'auraient pas voulu ces mantilles
Que vous êtes fières d'avoir,
Les autrefois !...
Les autrefois, quand on faisait l'amour,
On ne se cachait de personne :
Filles et garçons, tout cela partait
Cueillir des noisettes ou des cerises ;
A la brune quand on revenait,
Chacun s'enfilait chez soi,
Les autrefois !…
Les autrefois !… A quoi sert de le dire !
On ne les fera pas revenir !...
L’hiver 1882-83 est glacial. Amélie supporte de moins en moins le froid. Ses rhumatismes la torturent. Elle ne quitte guère son fauteuil, ne peut presque plus tenir sa plume et elle tousse de plus en plus. Elle tousse, elle tousse, « n’y fait pas attention », mais au soir du 17 juin 1883, Amélie meurt dans les bras de son amie, Mme Landriani.
Son corps reposa pendant 15 ans dans le cimetière de Chambéry, puis, sa tombe disparut lors de l’agrandissement du cimetière. Son nom fut donné à une allée du parc de Lémenc. A Challes-les-Eaux, une rue porte son nom en souvenir d’elle. A la chapelle Blanche, une stèle est érigée en sa mémoire et le petit chemin qui mène à son ancienne propriété est joliment baptisé Le Chemin du Poète.
Mai 2016
Pierre Grasset